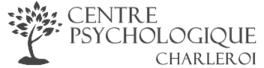Ils sont nés dans un monde déjà marqué par le dérèglement climatique. Ils ont grandi avec des images d’incendies incontrôlables, d’ouragans de plus en plus violents, de réfugiés climatiques, d’espèces disparues, de forêts décimées. Aujourd’hui, cette génération — qu’on appelle parfois la « génération climat » — vit une double urgence : une urgence écologique, bien sûr, mais aussi une urgence mentale, plus silencieuse, plus difficile à détecter, mais tout aussi préoccupante.
À mesure que les rapports scientifiques deviennent plus alarmants, à mesure que les promesses politiques tardent à se concrétiser, un mal-être grandit chez les jeunes. Ce mal a un nom : l’éco-anxiété. Ce n’est pas une invention médiatique ni une tendance passagère. C’est une réaction émotionnelle légitime à une réalité menaçante, une angoisse profonde face à la destruction du vivant et à l’incertitude de l’avenir.
Pour cette génération, penser à demain ne se fait plus avec insouciance. Planifier une carrière, envisager une famille, voyager, rêver à un futur lointain — autant de projets que beaucoup regardent désormais avec scepticisme ou crainte. L’idée même d’avenir est devenue floue, instable, presque étrangère. Et cette perte de projection a un coût psychologique immense.
L’éco-anxiété se manifeste de différentes façons : tristesse chronique, sentiment d’impuissance, colère envers les générations précédentes, stress intense, troubles du sommeil, parfois même désespoir. Certains jeunes expriment une culpabilité constante à vivre dans un système qu’ils jugent destructeur, à consommer, à prendre l’avion, à manger de la viande. D’autres s’investissent corps et âme dans des actions militantes, jusqu’à l’épuisement émotionnel, voire la fatigue militante.
Face à cette souffrance, la société reste souvent désarmée, voire dans le déni. On dit aux jeunes qu’ils exagèrent, qu’ils devraient « profiter de la vie », qu’ils sont trop anxieux ou trop radicaux. On les pousse à se conformer à des modèles de réussite qui ne font plus sens pour eux. Mais comment demander à une génération de construire sa vie sur un monde en ruine ?
Ce fossé entre la conscience aiguë des jeunes et la lenteur de la réaction collective crée un sentiment d’isolement profond. Pourtant, cette détresse ne demande qu’à être entendue. Elle n’est pas une faiblesse, mais une preuve de lucidité. C’est une souffrance née de la capacité à aimer le monde, à ressentir la beauté de la nature, à vouloir la préserver. Et c’est justement parce qu’ils se sentent responsables, impliqués, que tant de jeunes en souffrent aujourd’hui.
Mais cette angoisse peut aussi devenir une force de transformation. Beaucoup la transforment en engagement politique, en création artistique, en projets durables, en gestes du quotidien. Cet engagement donne du sens, crée du lien, redonne du pouvoir d’agir. Mais il ne peut pas se faire seul. Il a besoin d’être soutenu, accompagné, légitimé.
Il est temps de considérer la santé mentale comme un pilier de la transition écologique. On ne bâtira pas un monde durable sans humains en capacité psychique de le rêver, de le construire, de le défendre. Prendre soin des émotions liées à la crise climatique, c’est aussi prendre soin de la planète.
Les institutions éducatives, les professionnels de santé mentale, les parents, les entreprises et les responsables politiques doivent reconnaître cette urgence psychologique. Cela passe par l’écoute, par la création d’espaces de parole dans les écoles et les universités, par l’éducation à l’environnement et aux émotions, mais aussi par des politiques écologiques à la hauteur des enjeux, pour montrer que l’action est possible, que tout n’est pas perdu.
Car ce que la « génération climat » exprime, derrière sa colère et son anxiété, c’est avant tout une demande de cohérence, de vérité, de solidarité intergénérationnelle. Elle ne demande pas qu’on lui enlève sa peur, mais qu’on la partage. Elle ne demande pas qu’on lui donne de faux espoirs, mais qu’on s’engage vraiment, ensemble.
L’urgence écologique est là. L’urgence mentale aussi. Et les deux ne peuvent plus être traitées séparément. C’est en prenant soin de la planète et des émotions qu’elle suscite que l’on pourra construire un avenir viable — pas seulement techniquement, mais aussi humainement.